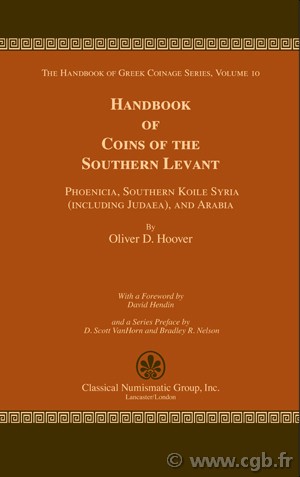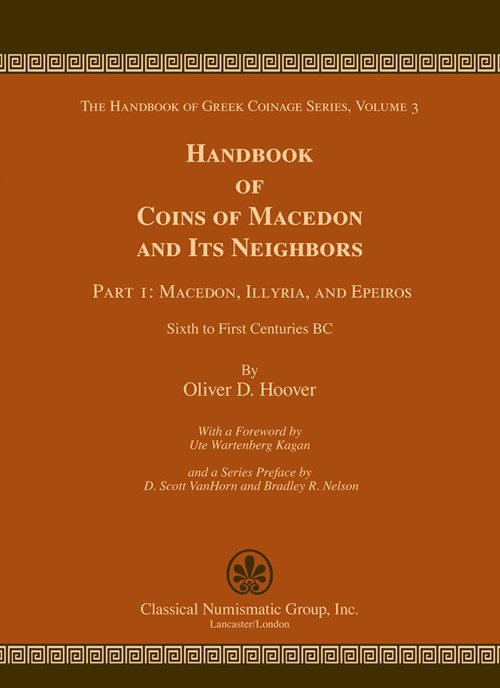Themes
   |
CARTHAGE : QUAND LES STATÈRES ÉTAIENT EN OR ! | 22/09/2025 Informations Dans la Live Auction du 23 septembre 2025, ce n’est pas un, ni deux, mais quatre statères d’or au nom et au type d’Alexandre III le Grand (336-323 avant J.-C.) qui vous sont proposés. Sur ces quatre statères d’or, deux sont de l’atelier de Tarse, un de l’atelier de Sidon et le dernier pour l’atelier de Tyr. Les deux premiers sont du même type et portent le même différent, un canthare (kantharos, gr., cantharus, lat. = vase ou coupe à boire à deux anses latérales, détachée de la panse, grecque d’origine, consacrée à Dionysos/ Bacchus). Trois de nos pièces ont été frappées du vivant ou peu après la mort du conquérant (14 juin 323 avant J.-C.). La dernière, celle de Tyr, est posthume, frappée entre la fin du IVe siècle avant J.-C. et le début du IIIe siècle avant J.-C. Au moment de la mort de Philippe II de Macédoine en 336 avant J.-C., le trésor est vide et Alexandre doit consolider son trône avant d’entamer sa campagne contre les Perses qui va le mener jusqu’aux portes de l’Inde. Il est aujourd’hui acquis que le monnayage au nom et au type d’Alexandre que nous connaissons tous ne débute pas à l’accession du nouveau basileos macédonien. Alexandre passe en Asie en 334 avant J.-C. Sa première victoire au Granique en mai 334 lui ouvre les portes de l’Anatolie, mais il faut attendre la prise de Tarse et la bataille d’Issos (Cilicie) en novembre 333 avant J.-C., pour lui offrir celles du cœur de l’Empire perse et de l’Asie. Mais Alexandre se retrouve bloqué devant Tyr et ne s’empare de la ville qu’après un siège très dur de sept mois. Il semble bien que l’atelier de Tarse ait été le premier à monnayer pour l’Empire après la prise de la cité en 333 avant J.-C. avec les monnaies d’argent inspirées par le Baal de Tarse. Pour l’or, le monnayage pourrait bien ne commencer qu’après la prise de Tyr en 332 avant J.-C., que rappellerait la Niké au revers avec la couronne et la stylis (symbole naval, étendard sorte de hampe, placée à l’intérieur du navire). Tyr se trouvait sur une île non loin de la côte et Alexandre afin d’en effectuer le siège dut faire réaliser un môle unissant l’île à la côte. Tyr était l’un des principaux ports de la côte levantine et siège d’une partie de la flotte achéménide, dirigée et commandée par d’habiles marins phéniciens. Ce nouveau type, qui au fil des conquêtes d’Alexandre va devenir la monnaie d’Empire tandis que les « Chrysous Philippeios » (Philippe d’or) sont ses correspondants pour le monde grec, les « Chrysous Alexandreios » (Alexandre d’or) vont se diffuser dans l’ensemble de l’Empire conquis par Alexandre, supplantant dans l’Empire achéménide la darique. La nouvelle dénomination, comme celle de son père, est calquée sur l’étalon attique avec une masse théorique de 8,60 g d’or pur (+ 98%) et qui équivaut à 30 drachmes d’argent attique d’une masse de 130 g d’argent pur environ avec un ratio 1 : 15. Le statère représentait la solde mensuelle d’un soldat macédonien. Au IVe siècle avant J.-C., un bouleute (député) athénien touchait 6 oboles ou une drachme pour une journée de session à la Boulé (assemblée). La nouvelle dénomination va connaître une diffusion inégalée jusqu’alors et être frappée pendant plus de deux siècles, circulant largement dans le monde grec, copiée et imitée, parfois dans les contrées les plus reculées en dehors du monde grec, jusque dans le « Barbaricum ». Sa masse aura tendance à légèrement s’abaisser chronologiquement, sa pureté restant intacte. Ses caractéristiques épigraphiques et iconographiques sont les suivantes. A/ Anépigraphe R/ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Des différents monétaires, des monogrammes prennent place de chaque côté de la Victoire. Après la mort du roi, le monnayage continue d’être frappé à son nom, pour celui de son fils à naître, Alexandre (323-310/309 avant J.-C.), complété par le titre de roi (Βασιλεωσ). Nous avons aussi un important monnayage au nom du demi-frère d’Alexandre, Philippe III Arrhidée (323-317 avant J.-C.) (ΦΙΛΠΠΟΥ). Les généraux d’Alexandre, Diadoques puis Épigones vont continuer à frapper monnaie au nom du souverain décédé avant d’y placer leur propre nom à partir de 306/305 avant J.-C., tout en maintenant le type monétaire de base, en remplaçant le nom d’Alexandre, par le leur : Lysimaque (ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ), Démétrius Poliorcète (ΔHMHTPIOY), Séleucus Ier Nicator (ΣEΛEYKOY)… Le nombre et la variété des types posthumes sont nombreux et ne se limitent pas aux monnaies royales. De nombreux ateliers des cités vont frapper des statères d’or immobilisés au nom et au type d’Alexandre. Le seul moyen de les reconnaître, c’est identifier leurs symboles (épisèmes) qui se trouvent dans le champ de la monnaie, agrémenté de lettres ou de monogrammes quand ces derniers ne sont pas les seuls moyens d’identifier les lieux d’émission. Depuis le XIXe siècle et les travaux de Carl Ludwig Müller (1809-1891) qui fut le premier à dresser l’inventaire de ces marques, Numismatique d’Alexandre le Grand, suivie d’un appendice contenant les monnaies de Philippe II et III, Copenhagen, 1855, toujours utile pour ses tables, nous avons pu commencer à mieux cerner ce monnayage gigantesque. Le deuxième à avoir œuvré afin de mieux faire connaître ce monnayage est l’Américain Edward Y. Newell (1886-1941) qui s’attacha, en particulier, à l’étude des ateliers levantins d’Alexandre, comme Tarse, Sidon ou Tyr entre autres. Mais il est remplacé aujourd’hui par l’ouvrage de Martin Price (1939-1995), The Coinage in the Name of Alexander the Great and Philip Arrhidaeus. A British Museum Catalog, London/ Zürich, 1991, 637 p., CLIX pl. Cet ouvrage, malheureusement épuisé et devenu fort cher (+500€), contient plus de 4 100 entrées pour l’ensemble du monnayage, complétées d’une quarantaine d’imitations et de plus de 100 faux. C’est grâce à ces nombreux index et tableaux de concordances (p. 515-637, en particulier pour les marques d’émissions des différents ateliers : symboles (p. 548-571), lettres et monogrammes (p. 571-632), que nous avons une vue d’ensemble du monnayage. Nous avons avec cet ouvrage un outil indispensable, complété depuis par les nouvelles découvertes qui ont été effectuées depuis sa publication. Revenons à nos quatre pièces de la Live Auction. Deux sont de l’atelier de Tarse, le premier qui aurait frappé au nom d’Alexandre et inaugurerait son monnayage. Pour l’or, la fabrication ne pourrait débuter avant la prise de Tyr en 332. La frappe commencerait entre ce moment et 330 avant J.-C. L’atelier fonctionnerait jusqu’à 323 avant J.-C., peu après la mort du roi. Nos deux statères appartiennent à la première phase du monnayage qui se termine c. 327 avant J.-C. Statère d’or, Cilicie, Tarse, 332/330-327 av. J-C., (Or, 8,60 g, 19,50 mm, 5 h) ; canthare dans le champ gauche du revers. Müller 193 var – Price 3004 – HGCS 3.1/ 893h – Newell Tarsus 14. Superbe exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Très beau portrait d’Athéna, bien venu à la frappe. Joli revers. Patine de collection. Très rare. SUP 3 000€/ 5 500€ Statère d’or, Cilicie, Tarse, 332/330-327 av. J-C., (Or, 8,46 g, 17,50 mm, 2 h) ; canthare dans le champ gauche du revers. Müller 193 var – Price 3004 – HGCS 3.1/ 893h – Newell Tarsus 14. Flan bien centré. Droit agréable, usure régulière. Jolie Niké au revers. Patine de collection. Très rare. TB+ 1 250€/ 2 500€ Cet exemplaire provient de la Live Auction de décembre 2023 (bgr_843229) (prix réalisé 2212€ + frais). Pour ce type, il existe deux variantes en fonction de la position du canthare dans le champ gauche de la pièce (Price 3004), placé devant l’aile de la Niké, nos deux exemplaires ou (Price 3005) sous l’aile. Nous n’avons pas relevé d’identité de coins entre les différents statères. En revanche, la chevelure d’Athéna, dans les deux cas, est composée de quatre grosses mèches enroulées en forme de torsade. L’exemplaire frappé à Sidon, n’est pas référencé dans le volume 3.1 de l’ouvrage d’Oliver D. Hoover, The Handbook of Greek Coinage Series, Handbook of Coins of Macedon and its Neighbors. Part I : Macedon, Illyria and Epeiros, Sixth to First Centuries BC, (HGCS 3. 1/), CNG, Lancaster/ London, 2016, mais dans le volume 10 de la même série : Handbook of Coins ot the Southern Levant. Phoenicia, Southern Koile Syria (including Judaea) and Arabia, Fifth to First Centuries BC, (HGCS 10), Lancaster/ London, 2010. Statère d’or, Phénicie, Sidon, an 10 = 324-323 avant J.-C. (Or, 8,59 g, 17 mm, 12 h) ; K devant l’aile et ΣI sous l’aile. Müller 1411 - Price 3494 – HGCS 10/ 266 – Newell Sidon 33. Bel exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Très joli revers, détaillé. Petite cassure de coin au droit. Patine de collection. Très rare. TTB 1 800€/ 3 500€ Même coin que l’exemplaire du British Museum (Price 3494a, pl. XII, entré en 1878). Ce type se rencontre dans le trésor de Saida (Liban) (IGCH 1508 ; trouvé entre 1829 et 1863, qui aurait contenu plus de 7000 statères d’or dont 41 identifiés, TPQ : c. 323-320 avant J.-C.) Avec son certificat d’exportation de bien culturel n°251137 délivré par le ministère français de la Culture. L’atelier de Sidon semble avoir été l’un des premiers à frapper des statères d’or dès l’origine vers 332 avant J.-C. et l’atelier semble fonctionner jusqu’en 306-305 avant J.-C. avec une production importante. Sidon en 333 avant J.-C., après la bataille d’Issos, a contrario de Tyr, avait ouvert ses portes à Alexandre quand il s’était présenté devant la cité. Le monnayage d’or et d’argent se décompose en deux grandes séries, la première non datée et la seconde datée avec des lettres phéniciennes ou grecques dans le champ gauche devant l’aile de la Niké tandis que les lettres ΣI, placées sous l’aile sont les initiales pour Sidon. Avec la lettre K (pour 10) ce serait la première marque avec une lettre grecque, soit la dixième lettre de l’alphabet qui en comporte 24, correspondant à l’année 334-333 après l’arrivée d’Alexandre devant la ville. La cité inaugurerait une numérotation débutant à alpha quand Sidon tombe sous le contrôle d’Antigone Monophtalmos (le Borgne) en 309-308 avant J.-C. (HGCS 10/ 268). Notre quatrième exemplaire a été frappé à Tyr, automatiquement après le siège et la quasi-destruction de la ville par Alexandre le Grand après un siège de sept mois. Pour Martin Price, en s’appuyant sur les travaux d’Edward T Newell (1886-1941), Tyrus Rediviva, New York, 1923, le monnayage serait posthume et ne débuterait pas avant c. 305 avant J.-C., au moment ou Antigone Monophtalmos (le Borgne) et son fils Démétrius Poliorcète (l’Assiégeur) s’emparent de la ville et au moment où le premier déclare la Liberté des Grecs et des cités. Tyr va rester dans l’orbite Antigonide jusqu’en 287 avant J.-C., au moment où Démétrius est fait prisonnier par son beau-père Séleucus Ier Nicator (Le Victorieux). Tyr passe alors sous le contrôle lagide de Ptolémée Ier Soter (323-283 avant J.-C.). L’atelier semble fonctionner sous contrôle Antigonide entre 305 et 290 avant J.-C. environ. Statère d’or, Phénicie, Tyr, (Or, 8,31 g, 18 mm, 12 h) ; deux monogrammes dans le champ, le premier à gauche, devant l’aile ; le second, dans le champ inférieur droit sous l’aile. Müller 1586 – Price 3554 – HGCS 10/ 350 – Newell Tyrus 22. Superbe monnaie sur un flan idéalement centré des deux côtés. Très beau revers, finement détaillé. Patine de collection. Très rare. SUP 3 500€/ 6 000€ Semble de même coin de droit que l’exemplaire du British Museum (Price 3554, pl. XIII, provenant du trésor de Larnaca, Chypre). Ce trésor fut trouvé en 1870 (IGCH 1472, composé d’un grand nombre de statères d’or, il fut acquis principalement par le British Museum et le Staatlische Museen de Berlin. Quatre statères d’or de Tyr sont aujourd’hui conservés au British Museum (Price, 3528, 3530, 3533 et 3554, TPQ : c. 300 avant J.-C.) Tous les statères d’or d’Alexandre se ressemblent, mais ne se valent pas. Si les ateliers d’Amphipolis ou de Babylone semblent au premier abord les plus courants, à l’intérieur d’un atelier, vous pouvez tomber sur un type ou une émission beaucoup moins courants et donc beaucoup plus chers. Il est donc indispensable de les examiner méticuleusement afin d’en découvrir l’intérêt numismatique. Vous l’aurez remarqué dans cet article, vous avez des prix de départ qui évoluent entre 1 250€ et 3 500€. Ce prix est variable en fonction de l’état de conservation bien sûr, et en premier lieu, mais aussi en fonction de l’émetteur, roi ou cité, du vivant ou posthume, daté précisément ou pas et aussi en fonction de la rareté potentielle de l’atelier de fabrication et de sa longévité. Certaines émissions très rares, sur une courte période, peuvent voir leur prix exploser. Enfin, même si vous ne lisez pas le grec ancien, regardez la légende de revers. Ce n’est pas toujours ΑΛEΞANΔPOY qui est figuré et une perle peut se cacher derrière un autre nom de roi. Marie BRILLANT & Laurent SCHMITT |
 Les boutiques cgb.fr Des dizaines de milliers de monnaies et billets de collection différents disponibles. Tous les livres et fournitures numismatiques pour classer vos monnaies et billets.  Les e-auctions - cgb.fr Prix de départ 1 Euro, pas de frais acheteur, les collectionneurs fixent le prix de l'article !  Le Bulletin Numismatique Retrouvez tous les mois 32 pages d'articles, d'informations, de photos sur les monnaies et les billets ainsi que les forums des Amis du Franc et des Amis de l'Euro.  Le e-FRANC Retrouvez la valeur de vos monnaies en Francs. De la 1 centime à la 100 Francs, de 1795 à 2001, toutes les cotations des pièces en Francs. |

cgb.fr - 36,rue Vivienne - F-75002 PARIS - FRANCE - mail: blog@cgb.fr
Mentions légales - Copyright ©1996-2014 - cgb.fr - Tous droits réservés




.jpg)