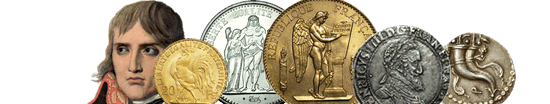Themes
   |
L’interdiction de la traite atlantique: intérêts, raison d'État et humanisme | 22/05/2018 Publications L’interdiction de la traite atlantique, ou comment concilier intérêts économiques, raison d’État et humanisme En 2006, Jacques Chirac, alors Président de la République française, décrétait le 10 mai « Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions ». Cette formulation rappelle que l’abolition de la traite n’entraîna pas celle de l’esclavage. En effet, dans les colonies des principales nations européennes et aux États-Unis trente à soixante années séparent la fin de la traite et l’abolition de l’esclavage. 
Elle représente un anglais et un africain se serrant la main. À l’arrière-plan à droite, des esclaves dansent autour d’un arbre, symbole de liberté. Cette médaille a été commanditée par les mouvements abolitionnistes qui pensaient que la fin de la traite améliorerait la condition des esclaves. Il n’en fut rien… Rappelons pour mémoire, que le Danemark interdit la traite dès 1803, la Grande-Bretagne en 1807, les États-Unis en 1808, les Pays-Bas en 1814 et enfin la France en 1815. L’abolition de l’esclavage n’intervint quant à elle qu’en 1836 dans les possessions britanniques, 1848 dans les colonies françaises, 1863 dans les colonies néerlandaises et enfin 1865 aux États-Unis. Pourquoi de tels écarts ? 
émis en 1964 pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane (réf. CGB Numismatique Paris b24_0652) Victor Schoelcher (1804-1893) fut le principal artisan du décret adopté le 27 avril 1848 abolissant enfin l’esclavage dans les colonies et possessions françaises. Rappelons enfin que l’appât du gain demeurant le plus fort, nombre de négriers occidentaux, notamment nantais, demeurèrent encore longtemps actifs dans la traite atlantique illégale. Celle-ci était alors orientée vers les pays où l’esclavage demeurait encore très présent et où son abolition fut la plus tardive : Porto Rico en 1872, Cuba en 1886 et le Brésil en 1888. 
Pièce de 100 cruzados commémorant le centenaire de l’abolition de l’esclavage au Brésil (réf. CGB Numismatique Paris fwo_378170) Les récents progrès de la recherche historique ont apporté des éléments de compréhension inédits notamment sur le plan de l’économie générale de la traite atlantique. Cependant pour révéler et comprendre les mécanismes économiques de la traite, il convient de synthétiser de très nombreux détails épars et d’étudier le temps long afin de prendre de la hauteur. Avant de commencer, je prie mes lecteurs d’excuser l’emploi ci-après de tournures parfois crues et déshumanisées, mais c’est un sacrifice obligé pour décrypter et dénoncer les mécanismes de ce commerce inhumain et ainsi mieux rendre hommage à la mémoire de ses victimes. L’augmentation du prix d’achat des esclaves en Afrique L’étude du prix d’achat des esclaves le long des côtes africaines a toujours été très difficile à cause des modalités même de l’échange et plus encore par la multiplicité des produits échangés : eau de vie, barres de fer, tissus, fusils, poudre, perles de verre, coquillages… Comment additionner ces diverses matières et surtout les convertir en valeurs européennes pour établir les comparaisons nécessaires à l’étude de l’évolution de leur prix dans le temps ? Quoique peu connu, voire négligé, il existait bel et bien alors un véritable système monétaire de référence le long de la Côte des esclaves dont la parité, ou plutôt les équivalences, avec les devises européennes nous sont connues. Celui-ci était basé sur le cauri, petit coquillage importé des îles Maldives, utilisé comme paléo-monnaie en Asie depuis l’Antiquité et introduit dans les comptoirs de traite de l’Ouest africain par les Portugais au XVIe siècle. Aussi curieux que cela puisse paraître à des esprits européens, et cela était déjà vrai au XVIIIe siècle, le cauri était véritablement la monnaie de la traite atlantique sur la base de laquelle toutes les transactions étaient référencées. Rappelons d’ailleurs avec force les mots d’Abiola Félix Iroko qui, le premier, écrivait dès 1985 « il n’est plus possible aujourd’hui, sous peine d’une approche superficielle, d’établir les différentes catégories de mercuriales dans l’acquisition des esclaves en Afrique Occidentale sans avoir recours aux cauris » 
L’utilisation monétaire de ce petit coquillage a durablement marqué les habitudes africaines. Il arrive aujourd’hui encore qu’il soit employé en appoint du franc CFA. Tous les récits laissés par les capitaines négriers actifs le long de la Côte des esclaves confirment unanimement l’augmentation exponentielle du prix de vente des esclaves exprimés en cauris dans le courant du XVIIIe siècle. En effet, à Ouidah, l’un des principaux comptoirs de traite de la Côte des esclaves, alors qu’un homme s’achetait pour 8.000 cauris en 1724, les négriers africains en demandaient 80.000 vers 1748 et le rochelais Joseph Crassous dut même parfois débourser l’équivalent de 192.000 coquilles en 1773 ! À Ouidah, le prix du captif a donc été multiplié par vingt-trois en un demi-siècle ! Deux facteurs principaux expliquent cette vertigineuse augmentation à peine croyable. Tout d’abord, la concurrence croissante à laquelle se livraient les nations européennes, concurrence aggravée par la libéralisation de la traite par la France en 1741 et l’Angleterre en 1750. Or, comme l’a si bien écrit Tidiane Diakité, cette concurrence n’était « pas de nature à tempérer l’ardeur et l’appétit des rois africains » car contrairement à l’idée reçue, les prix de vente des esclaves n’était pas fixé par les négriers européens, mais par les négriers africains. D’où, l’autre raison de cette hausse des prix : la prise de bénéfice toujours croissante des négriers africains, en tête desquels les rois. C’est un sujet crucial et pourtant encore trop souvent tabou et mal documenté. Par exemple, on estime qu’en 1750 le roi du Dahomey tirait déjà un revenu annuel de 250.000 livres sterling sur la vente directe de 9.000 captifs. Ce bénéfice était considérable puisqu’il était cinq à six fois supérieur aux revenus du plus gros propriétaire foncier britannique d’alors ! De plus, pour être complet, cette question des bénéfices africains tirés de la traite doit être élargie aux autres très nombreux intermédiaires vivant de cette activité : traducteurs, courtiers, porteurs, sans oublier les vendeurs de produits alimentaires… Aussi dur que cela puisse être à accepter, l’exemple de Ouidah a incontestablement démontré que l’activité commerciale locale générée par la traite bénéficiait à une large part de la population. D’ailleurs, si les capitaines des navires européens souhaitaient réaliser leurs achats au plus vite, c’est aussi et surtout parce que chaque journée d’escale leur coûtait cher, car au prix d’achat des esclaves s’ajoutaient la fiscalité, directe et indirecte, ainsi que d’innombrables dépenses annexes. De nombreux capitaines ont d’ailleurs laissé des témoignages s’agaçant que tous les prétextes étaient bons pour faire payer les Européens, y compris les fâcheries, réelles ou feintes… Olivier Grenouilleau le résume très bien en écrivant « quant à l’habileté commerciale des Africains, il ne fait guère de doute qu’elle est très ancienne, et les Portugais furent, à leurs dépens, les premiers Occidentaux à s’en rendre compte, dès le XVe siècle ». Ainsi, au fil des années, les bénéfices des Africains augmentaient à mesure que diminuaient mécaniquement ceux des Européens. S’ajoute à la fin du siècle une troisième raison à cette hausse du prix des esclaves : la difficulté de plus en plus réelle pour les négriers africains de trouver de nouveaux captifs, les amenant à rechercher des victimes toujours plus loin, mais surtout toujours plus jeunes... L’augmentation du prix de vente des esclaves aux Amériques Comme en Afrique, les modalités de l’échange rendent difficiles les calculs du prix de vente réel d’un esclave aux Antilles. Ces calculs sont encore compliqués par d’importantes disparités observées entre les prix en fonction des lieux et des dates des ventes, mais aussi de la « qualité » des marchandises échangées de part et d’autre. Toutefois, les archives confirment l’augmentation constante du prix de vente des esclaves aux Antilles durant le XVIIIe siècle. Ainsi, le prix moyen d’un homme en bonne santé qui était de 1.000 à 1.400 livres vers 1750 passa à 2.400 livres et plus en 1787. D’évidence ceci atteste que les négriers européens ont partiellement répercuté sur leurs acheteurs antillais et américains la hausse de leur coût de revient des captifs en Afrique. Aux Antilles, l’achat d’un esclave s’y faisait presque toujours en plusieurs versements s’échelonnant sur quelques années, souvent entre deux et quatre ans. Or, les récentes recherches archéologiques et anthropologiques établissent l’espérance de vie d’un esclave sur une plantation à dix ans environ. Pour simplifier, on peut donc affirmer que pendant la première moitié de sa vie sur la plantation l’esclave rapportait de quoi permettre au maître de rembourser son achat, puis durant la seconde moitié de son existence il travaillait exclusivement au profit de son propriétaire. 
Outre les marchandises comme le sucre, l’indigo, le café… C’est avec ce type de pièces que les colons réglaient l’achat des esclaves aux capitaines négriers Aussi, même si l’achat d’esclaves étaient un poste budgétaire important dans la comptabilité des gestionnaires de plantation, les propriétaires n’avaient aucune question de rentabilité à se poser. En effet, sauf bien sûr dans le cas d’une fuite (ou marronage) ou d’un décès prématuré dû à la maladie ou à un accident, à la mort de l’esclave, il suffisait aux planteurs d’en acheter un autre qui serait également vite amorti. Or, l’importante augmentation du prix de l’esclave a immanquablement mis à mal cet équilibre. Le gouverneur de la Martinique Fénelon fut parmi les premiers à pressentir ce « danger » en écrivant dès 1764 : « un de mes étonnements a toujours été que la population de cette espèce n’ait point produit, depuis que les colonies sont fondées, non pas de quoi se passer absolument des envois de la côte d’Afrique, mais au moins de quoi former un fonds, dont la reproduction continuelle n’exposerait pas à être toujours à la merci de ces envois ». Fénelon dénonçait ici le risque d’être dépendant des livraisons d’esclaves avant tout fournis par les négriers africains, les négriers européens n’étant quant à eux que des intermédiaires secondaires assurant le transport. Ainsi, contraints de payer les esclaves beaucoup plus cher, les planteurs ne pouvaient plus aussi facilement en assurer l’amortissement. Les solutions n’étaient pas légions… Accroître le rendement de chaque esclave ? Pour cela, il aurait fallu pouvoir augmenter les cadences de travail, mais les temps de repos des esclaves étaient déjà tellement faibles qu’ils ne pouvaient être encore significativement réduits. Accroître la rentabilité des esclaves ? Cela aurait imposer d’augmenter les cours des matières coloniales comme le sucre, le café, l’indigo… or cela ne relevait pas des planteurs, mais de leurs acheteurs européens. La seule solution était donc de réduire le coût de revient de l’esclave et ceci ne pouvait se faire que par la réduction du nombre d’achats. C’est ainsi que les planteurs furent contraints de passer du simple remplacement « automatique » de l’esclave à la mise en application des théories de Fénelon et consorts sur « l’élevage des esclaves », dans une démarche que l’on qualifierait aujourd’hui de « gestion durable de la ressource ». L’esclave étant devenu trop cher pour être amorti devait être « préservé » et/ou « produit » localement. Dès lors, les captifs ne devaient plus être, selon l’expression d’alors, « chassés » dans l’arrière-pays des côtes africaines avant d’être acheminés jusqu’aux Amériques, mais y être directement « produits ». Il en découla tout d’abord que si les esclaves du XVIIIe siècle pouvaient se rappeler leurs jeunes années de liberté, ceux du XIXe siècle n’allaient plus connaître qu’une vie de captivité depuis le berceau jusqu’au tombeau. Première pièce à l’effigie d’une afro-américaine : 100 dollars « black Liberty » frappée en 2017 Il en découla aussi une importance accrue des femmes qui n’étaient plus simplement des bras pour le travail, mais aussi des utérus pour la reproduction et l’accroissement de l’appareil productif, pour ne pas dire du « cheptel ». Il ne peut y avoir d’autre explication à la réduction progressive et constante de l’écart entre le prix de vente d’un homme et d’une femme. À nouveau à Ouidah, alors qu’une femme se vendait moitié moins cher qu’un homme durant la première partie du XVIIIe siècle, leurs prix respectifs devinrent quasiment identiques en 1773 ! Enfin, de nombreuses sources montrent que les prix entre hommes et femmes vont même s’inverser durant les premières années du XIXe siècle : une femme coûtait désormais plus cher qu’un homme, surtout quand celle-ci était joli. Les raisons économiques à l’interdiction de la traite atlantique Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, les négriers européens se retrouvèrent donc coincés entre des fournisseurs africains toujours plus gourmands et des acheteurs antillais et américains de moins en moins emballés… Leurs bénéfices directs s’en trouvèrent fortement amputés, de même que les profits induits pour leurs États respectifs. Or, les retombées positives de la traite sur les économies nationales ont partout et toujours été le prétexte mis en avant par les négriers pour justifier leur activité. Cette amputation des profits fut encore plus forte pour les négriers français quand ceux-ci se retrouvèrent privés de leur principal débouché après la révolution haïtienne. Il n’est donc pas étonnant que les toutes premières années du XIXe siècle aient été à ce point marquées par des faillites d’armateurs négriers français dues à la mévente des esclaves aux Antilles. Cette mévente fut encore aggravée après 1812 et l’invention de la machine permettant l’extraction du sucre de la betterave qui fit rapidement baisser le prix de « l’or blanc » des Antilles tout en réduisant les besoins en main d’œuvre nécessaire à sa production. 
Le revers est didié à Thomas Spence, Thomas More et Thomas Paine, avocats des Droits de l’Homme. La baisse de la rentabilité de la traite atlantique est donc manifeste et pourtant celle-ci n’est pour ainsi dire jamais évoquée parmi les raisons qui ont conduit à son abolition par les principales nations occidentales, alors que l’Humanisme est presque toujours le seul argument mis en avant. Pourquoi ? Depuis la fin du Siècle des Lumières, les gouvernements devaient faire face à une pression toujours plus importante de la part des mouvements abolitionnistes, même si ceux-ci durent se faire plus discrets en France suite aux massacres de Saint-Domingue de 1791. Proclamer l’interdiction de la traite pour des raisons humanistes étaient donc bien sûr de nature à relâcher cette pression, et pouvait aussi servir aux romans nationaux des « nations éclairées », des « pays de la Liberté » et autres « patries des Droits de l’Homme ». 
de l’abolition de la traite par la Grande-Bretagne La situation avait donc bien changé au début du XIXe siècle : les armateurs négriers devenus moins nombreux ne constituaient plus un groupe d’influence suffisant, tandis que l’interdiction de la traite permettait aux États esclavagistes de redorer leur blason et de calmer les mouvements abolitionnistes, parmi lesquels la puissante franc-maçonnerie, tout en ménageant les intérêts des planteurs et sans porter atteinte à leurs partenaires de métropole occupés à transformer le sucre et les autres marchandises coloniales. Il ne faut donc pas se laisser leurrer : l’interdiction de la traite était bien sûr due à la nouvelle donne politico-économique, tandis que l’humanisme restait très largement secondaire, sinon le fléau de l’esclavage aurait été supprimé en même temps et non pas des décennies plus tard. Lorsqu’on évoque la douloureuse mémoire de la traite, c’est souvent la responsabilité individuelle de tel ou tel négrier qui est mise en avant. Pourtant, le maintien de la traite, puis la prolongation de l’esclavage, relèvent avant tout de la responsabilité des États. Par la création de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage récemment annoncée par le président Macron, la France regarde son passé avec courage et assume sa responsabilité en ne laissant pas « de douleurs oubliées dans la mémoire nationale ». Toutefois, « autant qu’un devoir de mémoire, l’histoire de l’esclavage ouvre un devoir d’avenir car la compréhension de ce qui a pu justifier ce commerce immonde doit être un outil pour conjurer la haine et le rejet de l’autre ». Gildas Salaün |
 Les boutiques cgb.fr Des dizaines de milliers de monnaies et billets de collection différents disponibles. Tous les livres et fournitures numismatiques pour classer vos monnaies et billets.  Les e-auctions - cgb.fr Prix de départ 1 Euro, pas de frais acheteur, les collectionneurs fixent le prix de l'article !  Le Bulletin Numismatique Retrouvez tous les mois 32 pages d'articles, d'informations, de photos sur les monnaies et les billets ainsi que les forums des Amis du Franc et des Amis de l'Euro.  Le e-FRANC Retrouvez la valeur de vos monnaies en Francs. De la 1 centime à la 100 Francs, de 1795 à 2001, toutes les cotations des pièces en Francs. |
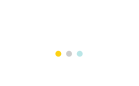
cgb.fr - 36,rue Vivienne - F-75002 PARIS - FRANCE - mail: blog@cgb.fr
Mentions légales - Copyright ©1996-2014 - cgb.fr - Tous droits réservés